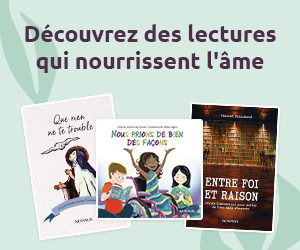– PREVIEW –
Comment recevoir la vie éternelle
P. Thomas Rosica
mardi 9 octobre 2012

 Les paroles de Jésus en Marc 10,23-25 provoquent la stupé- faction des disciples parce qu’elles semblent contredire le concept vétérotestamentaire (Marc 10,24.26). Mais parce que la richesse, le pouvoir et le mérite génèrent un faux sentiment de sécurité, Jésus refuse qu’ils puissent justifier le moindre droit sur le Royaume. La conclusion négative et le fait que l’homme décide de s’en aller apportent une note de réalisme.
Ils rappellent aussi le pouvoir particulier des biens maté- riels qui empêchera plusieurs chrétiens d’être de véritables disciples. Jésus se sert du départ de l’homme riche pour enseigner à ses disciples que les biens terrestres, le succès et la prospérité peuvent être de dangereux pièges. Le détachement complet de ses biens est exigé de chaque disciple authentique. Jésus voyait le danger des biens matériels. Ils peuvent détour- ner notre cœur vers le monde et nous faire tout voir en termes de prix et non en termes de valeur.
Jésus essayait de subvertir complètement ce que les apô- tres et tous les bons Juifs avaient appris. Mais son enseigne- ment sur la richesse était incompréhensible pour son audi- toire. Lorsque Jésus dit, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d’entrer dans le royaume de Dieu, » l’Évangile continue : « De plus en plus déconcertés, les dis- ciples se demandaient entre eux : “Mais alors, qui peut être sauvé?” » (verset 26).
N’importe qui d’entre nous poserait naturellement la même question! Jésus leur a rappelé que le salut est pur don de Dieu. La grâce est un don de Dieu et seuls ceux dont les bras et les mains se sont vidés d’eux-mêmes peuvent s’ouvrir au don de la grâce. L’accomplissement du salut est au-delà de la capacité humaine et dépend uniquement de la bonté de Dieu qui l’offre comme un don (Marc 10,27).
Un défi pour chaque chrétien
Dans plusieurs sociétés, la richesse est encore un signe de l’approbation de Dieu alors que la pauvreté et les épreuves indiquent le désaveu divin. Chaque chrétien est interpellé par l’enseignement de Jésus et par les valeurs de la société, pour qui seuls les biens matériels ont une véritable valeur, comme le nombre de voitures qu’on possède, la taille de sa maison, le montant de ses placements en bourse.
Lorsque des systèmes capitalistes n’obéissent qu’aux lois du marché, matérialistes et sans cœur, ils contredisent les enseignements de Jésus dans l’Évangile. L’Évangile de Jésus conteste « l’Évangile de la prospérité ». Jésus ne dénonce pas la richesse matérielle, il condamne l’asservissement à la richesse.
Celle-ci est une bénédiction lorsqu’elle est partagée avec d’autres mais elle devient un obstacle et une prison pour ceux qui n’ont pas la sagesse de la partager avec d’autres.
En regardant le jeune homme riche, Jésus regardait chacun de nous avec amour. Il nous rappelle qu’il faut faire un « petit effort de plus. » Nous sommes invités à laisser son amour pénétrer nos cœurs et, contrairement au jeune homme, il faut nous ouvrir à l’idée de transformer notre vie et de mettre nos priorités en ordre.
Quand plusieurs disciples quittèrent Jésus parce qu’ils jugeaient son message trop exigeant, il demanda à ceux qui restaient : « Voulez-vous partir, vous aussi? »
Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, vers qui pour- rions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle » (Jean 6,67-68). Et ils choisirent de demeurer avec lui. Ils sont restés parce que le Maître avait « les paroles de la vie éternelle », des paroles qui étaient une promesse d’éternité et qui donnaient un sens à la vie sur terre.
La sagesse et le bonheur
Les paroles de Jésus en Marc 10,23-25 provoquent la stupé- faction des disciples parce qu’elles semblent contredire le concept vétérotestamentaire (Marc 10,24.26). Mais parce que la richesse, le pouvoir et le mérite génèrent un faux sentiment de sécurité, Jésus refuse qu’ils puissent justifier le moindre droit sur le Royaume. La conclusion négative et le fait que l’homme décide de s’en aller apportent une note de réalisme.
Ils rappellent aussi le pouvoir particulier des biens maté- riels qui empêchera plusieurs chrétiens d’être de véritables disciples. Jésus se sert du départ de l’homme riche pour enseigner à ses disciples que les biens terrestres, le succès et la prospérité peuvent être de dangereux pièges. Le détachement complet de ses biens est exigé de chaque disciple authentique. Jésus voyait le danger des biens matériels. Ils peuvent détour- ner notre cœur vers le monde et nous faire tout voir en termes de prix et non en termes de valeur.
Jésus essayait de subvertir complètement ce que les apô- tres et tous les bons Juifs avaient appris. Mais son enseigne- ment sur la richesse était incompréhensible pour son audi- toire. Lorsque Jésus dit, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d’entrer dans le royaume de Dieu, » l’Évangile continue : « De plus en plus déconcertés, les dis- ciples se demandaient entre eux : “Mais alors, qui peut être sauvé?” » (verset 26).
N’importe qui d’entre nous poserait naturellement la même question! Jésus leur a rappelé que le salut est pur don de Dieu. La grâce est un don de Dieu et seuls ceux dont les bras et les mains se sont vidés d’eux-mêmes peuvent s’ouvrir au don de la grâce. L’accomplissement du salut est au-delà de la capacité humaine et dépend uniquement de la bonté de Dieu qui l’offre comme un don (Marc 10,27).
Un défi pour chaque chrétien
Dans plusieurs sociétés, la richesse est encore un signe de l’approbation de Dieu alors que la pauvreté et les épreuves indiquent le désaveu divin. Chaque chrétien est interpellé par l’enseignement de Jésus et par les valeurs de la société, pour qui seuls les biens matériels ont une véritable valeur, comme le nombre de voitures qu’on possède, la taille de sa maison, le montant de ses placements en bourse.
Lorsque des systèmes capitalistes n’obéissent qu’aux lois du marché, matérialistes et sans cœur, ils contredisent les enseignements de Jésus dans l’Évangile. L’Évangile de Jésus conteste « l’Évangile de la prospérité ». Jésus ne dénonce pas la richesse matérielle, il condamne l’asservissement à la richesse.
Celle-ci est une bénédiction lorsqu’elle est partagée avec d’autres mais elle devient un obstacle et une prison pour ceux qui n’ont pas la sagesse de la partager avec d’autres.
En regardant le jeune homme riche, Jésus regardait chacun de nous avec amour. Il nous rappelle qu’il faut faire un « petit effort de plus. » Nous sommes invités à laisser son amour pénétrer nos cœurs et, contrairement au jeune homme, il faut nous ouvrir à l’idée de transformer notre vie et de mettre nos priorités en ordre.
Quand plusieurs disciples quittèrent Jésus parce qu’ils jugeaient son message trop exigeant, il demanda à ceux qui restaient : « Voulez-vous partir, vous aussi? »
Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, vers qui pour- rions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle » (Jean 6,67-68). Et ils choisirent de demeurer avec lui. Ils sont restés parce que le Maître avait « les paroles de la vie éternelle », des paroles qui étaient une promesse d’éternité et qui donnaient un sens à la vie sur terre.
La sagesse et le bonheur
 Le roi Salomon, comme on le voit dans la première lecture (Sagesse 7,7-11), avait compris que seule la vraie sagesse peut apporter le bonheur. Il la demanda et ne demanda qu’elle, plutôt que la richesse, le pouvoir, la santé ou une belle appa- rence. Dieu lui donna tout.
Pour nous, la sagesse est devenue une personne et elle porte le nom de Jésus. La sagesse est née dans une crèche et elle est morte sur la croix; entre-temps, elle nous a dit qu notre seule chance d’être comblé un jour, c’est de marcher à sa suite et d’aimer en nous dépouillant.
Regarder Jésus, c’est voir ce que signifie être pauvre en esprit, doux et miséricordieux, pleurer, avoir le sens de la jus- tice et le cœur pur, être artisan de paix, subir la persécution. C’est cela qu’il a le droit de nous dire, à chacune et chacun de nous : « Viens, suis-moi! »
Il ne secontente pas de dire: «Faiscequejetedis.» Ildit: « Viens, suis-moi! »
En définitive, Jésus regarde intensément et amoureuse- ment chacune et chacun de nous, et nous rappelle que pour avoir accès à la vie en plénitude, il ne faut pas accumuler les choses, les honneurs, les privilèges, les éloges et le prestige, mais lâcher prise.
Au début, son invitation peut nous surprendre, nous irriter, nous choquer, nous peiner. Avec la grâce de Dieu, puissions-nous comprendre que la parole de Jésus est vivante et efficace, qu’elle est plus acérée qu’un glaive à deux tran- chants, qu’elle pénètre entre l’âme et l’esprit, à la jonction de la moelle et des articulations et qu’elle peut discerner les desseins et les pensées du cœur (Hébreux 4,12-13). Espérons que nous ne nous éloignerons pas, le cœur lourd.
La vie de tous les jours
Après la lecture de l’Évangile de ce dimanche, je vous encou- rage à considérer trois enseignements importants de notre tradition catholique, tirés du Catéchisme de l’Église catholique et de l’encyclique de Benoît XVI, Caritas in Veritate.
Le roi Salomon, comme on le voit dans la première lecture (Sagesse 7,7-11), avait compris que seule la vraie sagesse peut apporter le bonheur. Il la demanda et ne demanda qu’elle, plutôt que la richesse, le pouvoir, la santé ou une belle appa- rence. Dieu lui donna tout.
Pour nous, la sagesse est devenue une personne et elle porte le nom de Jésus. La sagesse est née dans une crèche et elle est morte sur la croix; entre-temps, elle nous a dit qu notre seule chance d’être comblé un jour, c’est de marcher à sa suite et d’aimer en nous dépouillant.
Regarder Jésus, c’est voir ce que signifie être pauvre en esprit, doux et miséricordieux, pleurer, avoir le sens de la jus- tice et le cœur pur, être artisan de paix, subir la persécution. C’est cela qu’il a le droit de nous dire, à chacune et chacun de nous : « Viens, suis-moi! »
Il ne secontente pas de dire: «Faiscequejetedis.» Ildit: « Viens, suis-moi! »
En définitive, Jésus regarde intensément et amoureuse- ment chacune et chacun de nous, et nous rappelle que pour avoir accès à la vie en plénitude, il ne faut pas accumuler les choses, les honneurs, les privilèges, les éloges et le prestige, mais lâcher prise.
Au début, son invitation peut nous surprendre, nous irriter, nous choquer, nous peiner. Avec la grâce de Dieu, puissions-nous comprendre que la parole de Jésus est vivante et efficace, qu’elle est plus acérée qu’un glaive à deux tran- chants, qu’elle pénètre entre l’âme et l’esprit, à la jonction de la moelle et des articulations et qu’elle peut discerner les desseins et les pensées du cœur (Hébreux 4,12-13). Espérons que nous ne nous éloignerons pas, le cœur lourd.
La vie de tous les jours
Après la lecture de l’Évangile de ce dimanche, je vous encou- rage à considérer trois enseignements importants de notre tradition catholique, tirés du Catéchisme de l’Église catholique et de l’encyclique de Benoît XVI, Caritas in Veritate.
- Le Catéchisme de l’Église catholique enseigne (2404-2405) que nos biens matériels nous sont confiés par Dieu non pas pour notre profit personnel mais pour le privilège de les utiliser pour le bien des autres. « La propriété d’un bien fait de son détenteur un administrateur de la Providence pour le faire fructifier et en communiquer les bienfaits à autrui, et d’abord à ses proches. Les biens de production – matériels ou immatériels – comme des terres ou des usines, des compétences ou des arts, requièrent les soins de leurs possesseurs pour que leur fécondité profite au plus grand nombre. Les détenteurs des biens d’usage et de consommation doivent en user avec tempérance, réservant la meilleure part à l’hôte, au malade, au pauvre. »
- « La seconde vérité est que le développement authentique de l’homme concerne unitairement la totalité de la per- sonne dans chacune de ses dimensions. Sans la perspec- tive d’une vie éternelle, le progrès humain demeure en ce monde privé de souffle. Enfermé à l’intérieur de l’histoire, il risque de se réduire à la seule croissance de l’avoir. L’humanité perd ainsi le courage d’être disponible pour les biens plus élevés, pour les grandes initiatives désinté- ressées qu’exige la charité universelle. « L’homme ne se développe pas seulement par ses propres forces, et le développement ne peut pas lui être simple- ment offert. Tout au long de l’histoire, on a souvent pensé que la création d’institutions suffisait à garantir à l’huma- nité la satisfaction du droit au développement. » (Caritas in Veritate, no 11)
- « Tandis que les pauvres du monde frappent aux portes de l’opulence, le monde riche risque de ne plus entendre les coups frappés à sa porte, sa conscience étant désormais incapable de reconnaître l’humain. Dieu révèle l’homme à l’homme; la raison et la foi collaborent pour lui montrer le bien, à condition qu’il veuille bien le voir; la loi natu- relle, dans laquelle resplendit la Raison créatrice, montre la grandeur de l’homme, mais aussi sa misère, quand il méconnaît l’appel de la vérité morale. » (Caritas in Veritate, no 75)
 Pour commander votre exemplaire de « Paroles faites chair, volume 2, année B », qui contient toutes les réflexions pour l’année B, visitez le site web du Service des éditions de la Conférence des évêques catholiques du Canada ou sur notre web.
Pour commander votre exemplaire de « Paroles faites chair, volume 2, année B », qui contient toutes les réflexions pour l’année B, visitez le site web du Service des éditions de la Conférence des évêques catholiques du Canada ou sur notre web.À lire aussi
Catégories: Église au Canada, Divers
Étiquettes : Église catholique Montréal, Jean-Claude Turcotte
Prier avec le pape Réflexion – Juillet 2025
vendredi 11 juillet 2025
 P. Edmund Lo, sj
P. Edmund Lo, sj
En ce mois de juillet, le Saint-Père nous invite à prier pour que nous apprenions à être toujours plus en mesure de discerner, pour choisir des chemins de vie et rejeter tout ce qui nous éloigne du Christ et de l’Évangile.
Prier avec le pape Réflexion – Juin 2025
vendredi 13 juin 2025
 P. Edmund Lo, sj
P. Edmund Lo, sj
En ce mois de juin, le Pape nous invite à prier pour grandir dans la compassion aÌ l’eìgard du monde, pour que chacun d'entre nous trouve la consolation dans une relation personnelle avec Jésus et apprenne, à partir de son Cœur, à avoir de la compassion pour le monde.
Survol sur le document Rerum Novarum
lundi 26 mai 2025
 Matthew Neugebauer
Matthew Neugebauer
Le pape Léon XIII est sur le point de redevenir un nom familier, maintenant que son dernier successeur a pris son nom. Une recherche rapide sur Google Trends révèle que le terme de recherche « Léon XIII » a atteint le sommet de sa popularité le 8 mai, jour de l'élection du pape Léon XIV.
Quel est le sens d’un nom ? Les plus grands papes de l’histoire qui s’appellent Léo
vendredi 23 mai 2025
 Matthew Neugebauer
Matthew Neugebauer
Le pape Léon XIV ! La réalité pleine d'espérance d'un nouveau Souverain Pontife commence à s'installer. Plus je le vois, plus je l'entends parler (même dans sa langue maternelle, l'anglais !), et plus je lis son nom, plus cette nouvelle ère de la vie de l'Église me semble familière.
Discours du pape Léon XIV aux membres du corps diplomatique
vendredi 16 mai 2025
 Pape Léon XIV
Pape Léon XIV
Le mercredi 16 mai 2025, le pape Léon XIV s'est adressé aux membres du corps diplomatique accrédités auprès du Saint-Siège. Son discours réaffirme l'engagement du Saint-Siège à poursuivre la paix, la justice et la vérité dans son activité diplomatique,
SUPPORT LABEL
$50
$100
$150
$250
OTHER AMOUNT
FAIRE UN DON