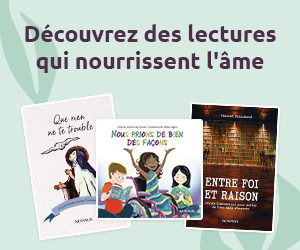– PREVIEW –
Emmanuel : la supplication et la promesse
P. Thomas Rosica
samedi 18 décembre 2010
 Tout l’Évangile de Matthieu porte sur l’accomplissement des Écritures saintes par Jésus. Dans la généalogie d’ouverture (Mt 1, 1-17), Jésus constitue le point culminant vers lequel la longue histoire d’alliance d’Israël menait, notamment dans sa dernière phase, énigmatique et tragique. Matthieu se trouve en accord avec ses contemporains juifs à savoir que l’exil était le dernier événement significatif avant Jésus; lorsque l’ange dit que Jésus « sauvera son peuple de ses péchés (Mt 1, 21), la libération de l’exil est en vue.
Le récit de l’enfance de Jésus que fait Matthieu (Mt 1, 1-2.23) forme le prologue de son Évangile. Composé d’une généalogie et de cinq histoires, il présente l’avènement de Jésus comme le point culminant de l’histoire d’Israël et les événements de sa conception, de sa naissance et de sa petite enfance, comme l’accomplissement des prophéties de l’Ancien Testament. Matthieu nous dit que la naissance de Jésus dans l’histoire humaine accomplit au moins trois thèmes bibliques. Il conduit Israël vers la Terre promise; « Jésus » étant la version grecque du prénom « Josué ». En tant qu’Emmanuel, « Dieu parmi nous », Jésus incarne la présence de Dieu parmi son peuple (Isaïe 7, 14, cité en Mt 1, 23). En tant que nouveau David, Jésus est le Messie né à Bethléem (Mt 2, 5, accomplissant Michée 5, 1-3).
Le premier récit d’enfance narré par Matthieu (v. 18-25) explique ce qui est indiqué dans Matthieu 1, 16. La conception virginale de Jésus est l’œuvre de l’Esprit de Dieu. La décision de Joseph de répudier de Marie est surmontée par le commandement céleste qu’il l’emmène dans sa maison et qu’il accepte l’enfant comme le sien. La lignée généalogique naturelle est brisée, mais les promesses faites à David sont accomplies; à grâce l’adoption par Joseph de l’enfant, ce dernier appartient à la famille de David. Matthieu voit dans la conception virginale de Jésus l’accomplissement du verset d’Isaïe 7, 14.
La justice de Joseph
Les fiançailles (v. 18) étaient la première partie d’un mariage, constituant un homme et une femme comme mari et femme. Toute infidélité subséquente était vue comme adultère. Quelques mois après les fiançailles, le mari emmenait sa femme dans sa maison et, à partir de ce moment, la vie conjugale normale commençait. On nous dit que Joseph était un homme juste (v. 19) qui observait avec dévotion la loi de Moïse. Joseph souhaitait rompre l’union avec une personne qu’il soupçonnait d’avoir commis une violation flagrante de la loi. On entend souvent dire que la loi le lui commandait ainsi, mais les textes habituellement cités pour soutenir cette affirmation (ex : Deut 22, 20-21) ne se rapportent pas clairement à la situation de Joseph.
Des échos de l’Ancien Testament
Dans l’Ancien Testament, l’expression « l’ange du Seigneur » (v.20) était une appellation commune pour dire que Dieu était en communication avec un être humain. La mention dans le récit de Matthieu des rêves de Joseph (Mt 2, 13.19.22) peut avoir pour but de rappeler les rêves de Joseph, fils de Jacob le patriarche (Genèse 35, 5-11.19). Un parallèle plus proche serait le rêve d’Amram, le père de Moïse, relaté par Flavius Josèphe [Antiquités 2,9,3; 212, 215-16]. Dans le judaïsme du premier siècle, le prénom hébreu de Jésus (v. 21) rappelle le prénom « Josué » (en grec, « Iesous ») qui signifie « Yahweh aide » et qui était interprété selon le sens de « le Seigneur sauve ».
Emmanuel : la supplication et la promesse
Dans Matthieu 1, 23, nous avons le mot évocateur « Emmanuel » – « Dieu parmi nous ». Matthieu voit dans la naissance de Jésus, par l’intermédiaire de qui Dieu est avec son peuple, l’accomplissement de la promesse de délivrance faite par Dieu à Juda au temps du prophète Isaïe. À la fin de l’Évangile de Matthieu, on fait également allusion à « Emmanuel » lorsque le Jésus ressuscité assure à ses disciples sa présence continue : « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » (Mt 28, 20). Dieu a en effet tenu parole en Jésus. Jésus accomplit véritablement le plan de Dieu en parole et en action, en désir et en présence, dans la chair et dans le sang.
Dans le prénom « Emmanuel » se trouve la réponse au plus ardent des désirs de l’humanité à travers les âges : le désir de Dieu. « Emmanuel », c’est à la fois une prière et une supplication de notre part et une promesse et une déclaration de la part de Dieu. Lorsque nous prononçons le mot, en réalité nous prions et supplions : « Dieu, soit avec nous! » Et lorsque Dieu le prononce, lui le Tout-Puissant, l’Éternel, le Créateur omniscient du monde, il nous dit : « Je suis avec vous » dans cet Enfant. En Jésus enfant, Dieu est « avec nous », non pas pour nous bénir simplement par une quelconque brève apparition à un moment difficile dans l’histoire. Il n’est pas davantage « avec nous » en ce sens qu'il utiliserait Jésus pour nous aider, nous protéger, nous sauver du péril et nous guider. Non – le petit Seigneur Jésus endormi dans la mangeoire de Bethléem est « Dieu avec nous » parce qu’il est Dieu.
Plus encore que tous les autres évangélistes, Matthieu prend grand soin de relever que les événements dans la vie de Jésus se sont produits « afin que soit accompli ce que le Seigneur avait dit par les prophètes » (Mt 2, 23). Finalement, au chapitre 1 verset 25, nous trouvons l’expression « jusqu’à ce qu’elle [Marie] ait mis au monde son fils ». L’évangéliste Matthieu veille à mettre l’accent sur le fait que Joseph n’était pas imputable pour la conception de Jésus. Le mot grec qui est traduit par « jusqu’à » ne signifie pas une conduite conjugale normale après la naissance de Jésus, mais elle ne l’exclut pas non plus.
La dimension eschatologique de la Parole de Dieu
Cette semaine, poursuivons la lecture de l’exhortation apostolique du pape Benoît XVI « Verbum Domini », en particulier la partie qui parle de « la dimensions eschatologique de la Parole de Dieu ».
Tout l’Évangile de Matthieu porte sur l’accomplissement des Écritures saintes par Jésus. Dans la généalogie d’ouverture (Mt 1, 1-17), Jésus constitue le point culminant vers lequel la longue histoire d’alliance d’Israël menait, notamment dans sa dernière phase, énigmatique et tragique. Matthieu se trouve en accord avec ses contemporains juifs à savoir que l’exil était le dernier événement significatif avant Jésus; lorsque l’ange dit que Jésus « sauvera son peuple de ses péchés (Mt 1, 21), la libération de l’exil est en vue.
Le récit de l’enfance de Jésus que fait Matthieu (Mt 1, 1-2.23) forme le prologue de son Évangile. Composé d’une généalogie et de cinq histoires, il présente l’avènement de Jésus comme le point culminant de l’histoire d’Israël et les événements de sa conception, de sa naissance et de sa petite enfance, comme l’accomplissement des prophéties de l’Ancien Testament. Matthieu nous dit que la naissance de Jésus dans l’histoire humaine accomplit au moins trois thèmes bibliques. Il conduit Israël vers la Terre promise; « Jésus » étant la version grecque du prénom « Josué ». En tant qu’Emmanuel, « Dieu parmi nous », Jésus incarne la présence de Dieu parmi son peuple (Isaïe 7, 14, cité en Mt 1, 23). En tant que nouveau David, Jésus est le Messie né à Bethléem (Mt 2, 5, accomplissant Michée 5, 1-3).
Le premier récit d’enfance narré par Matthieu (v. 18-25) explique ce qui est indiqué dans Matthieu 1, 16. La conception virginale de Jésus est l’œuvre de l’Esprit de Dieu. La décision de Joseph de répudier de Marie est surmontée par le commandement céleste qu’il l’emmène dans sa maison et qu’il accepte l’enfant comme le sien. La lignée généalogique naturelle est brisée, mais les promesses faites à David sont accomplies; à grâce l’adoption par Joseph de l’enfant, ce dernier appartient à la famille de David. Matthieu voit dans la conception virginale de Jésus l’accomplissement du verset d’Isaïe 7, 14.
La justice de Joseph
Les fiançailles (v. 18) étaient la première partie d’un mariage, constituant un homme et une femme comme mari et femme. Toute infidélité subséquente était vue comme adultère. Quelques mois après les fiançailles, le mari emmenait sa femme dans sa maison et, à partir de ce moment, la vie conjugale normale commençait. On nous dit que Joseph était un homme juste (v. 19) qui observait avec dévotion la loi de Moïse. Joseph souhaitait rompre l’union avec une personne qu’il soupçonnait d’avoir commis une violation flagrante de la loi. On entend souvent dire que la loi le lui commandait ainsi, mais les textes habituellement cités pour soutenir cette affirmation (ex : Deut 22, 20-21) ne se rapportent pas clairement à la situation de Joseph.
Des échos de l’Ancien Testament
Dans l’Ancien Testament, l’expression « l’ange du Seigneur » (v.20) était une appellation commune pour dire que Dieu était en communication avec un être humain. La mention dans le récit de Matthieu des rêves de Joseph (Mt 2, 13.19.22) peut avoir pour but de rappeler les rêves de Joseph, fils de Jacob le patriarche (Genèse 35, 5-11.19). Un parallèle plus proche serait le rêve d’Amram, le père de Moïse, relaté par Flavius Josèphe [Antiquités 2,9,3; 212, 215-16]. Dans le judaïsme du premier siècle, le prénom hébreu de Jésus (v. 21) rappelle le prénom « Josué » (en grec, « Iesous ») qui signifie « Yahweh aide » et qui était interprété selon le sens de « le Seigneur sauve ».
Emmanuel : la supplication et la promesse
Dans Matthieu 1, 23, nous avons le mot évocateur « Emmanuel » – « Dieu parmi nous ». Matthieu voit dans la naissance de Jésus, par l’intermédiaire de qui Dieu est avec son peuple, l’accomplissement de la promesse de délivrance faite par Dieu à Juda au temps du prophète Isaïe. À la fin de l’Évangile de Matthieu, on fait également allusion à « Emmanuel » lorsque le Jésus ressuscité assure à ses disciples sa présence continue : « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » (Mt 28, 20). Dieu a en effet tenu parole en Jésus. Jésus accomplit véritablement le plan de Dieu en parole et en action, en désir et en présence, dans la chair et dans le sang.
Dans le prénom « Emmanuel » se trouve la réponse au plus ardent des désirs de l’humanité à travers les âges : le désir de Dieu. « Emmanuel », c’est à la fois une prière et une supplication de notre part et une promesse et une déclaration de la part de Dieu. Lorsque nous prononçons le mot, en réalité nous prions et supplions : « Dieu, soit avec nous! » Et lorsque Dieu le prononce, lui le Tout-Puissant, l’Éternel, le Créateur omniscient du monde, il nous dit : « Je suis avec vous » dans cet Enfant. En Jésus enfant, Dieu est « avec nous », non pas pour nous bénir simplement par une quelconque brève apparition à un moment difficile dans l’histoire. Il n’est pas davantage « avec nous » en ce sens qu'il utiliserait Jésus pour nous aider, nous protéger, nous sauver du péril et nous guider. Non – le petit Seigneur Jésus endormi dans la mangeoire de Bethléem est « Dieu avec nous » parce qu’il est Dieu.
Plus encore que tous les autres évangélistes, Matthieu prend grand soin de relever que les événements dans la vie de Jésus se sont produits « afin que soit accompli ce que le Seigneur avait dit par les prophètes » (Mt 2, 23). Finalement, au chapitre 1 verset 25, nous trouvons l’expression « jusqu’à ce qu’elle [Marie] ait mis au monde son fils ». L’évangéliste Matthieu veille à mettre l’accent sur le fait que Joseph n’était pas imputable pour la conception de Jésus. Le mot grec qui est traduit par « jusqu’à » ne signifie pas une conduite conjugale normale après la naissance de Jésus, mais elle ne l’exclut pas non plus.
La dimension eschatologique de la Parole de Dieu
Cette semaine, poursuivons la lecture de l’exhortation apostolique du pape Benoît XVI « Verbum Domini », en particulier la partie qui parle de « la dimensions eschatologique de la Parole de Dieu ».
14. À travers tout cela, l’Église exprime qu’elle est consciente de se trouver, avec Jésus-Christ, face à la Parole définitive de Dieu; il est « le Premier et le Dernier » (Ap 1, 17). Il a donné à la création et à l’histoire son sens définitif; c’est pourquoi nous sommes appelés à vivre le temps, à habiter la création de Dieu selon le rythme eschatologique de la Parole; « l’économie chrétienne, du fait qu’elle est l’Alliance nouvelle et définitive, ne passera jamais et aucune nouvelle révélation publique ne doit plus être attendue avant la glorieuse manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ » (cf. 1 Tm 6, 14 et Tt 2, 13). En effet, comme l’ont rappelé les Pères durant le Synode, « la spécificité du Christianisme se manifeste dans l’événement Jésus-Christ, sommet de la Révélation, accomplissement des promesses de Dieu et médiateur de la rencontre entre l’homme et Dieu. Lui “qui nous a révélé Dieu” (cf. Jn 1, 18) est la Parole unique et définitive donnée à l’humanité ». Saint Jean de la Croix a exprimé cette vérité de façon admirable : « Dès lors qu’il nous a donné son Fils, qui est sa Parole – unique et définitive –, il nous a tout dit à la fois et d’un seul coup en cette seule Parole et il n’a rien de plus à dire. […] Car ce qu’il disait par parties aux prophètes, il l’a dit tout entier dans son Fils, en nous donnant ce tout qu’est son Fils. Voilà pourquoi celui qui voudrait maintenant interroger le Seigneur et lui demander des visions ou révélations, non seulement ferait une folie, mais il ferait injure à Dieu, en ne jetant pas les yeux uniquement sur le Christ et en cherchant autre chose ou quelque nouveauté ». Par conséquent, le Synode a recommandé « d’aider les fidèles à bien distinguer la Parole de Dieu des révélations privées », dont le rôle « n’est pas de (…) “compléter” la Révélation définitive du Christ, mais d’aider à en vivre plus pleinement à une certaine époque de l’histoire ». La valeur des révélations privées est foncièrement différente de l’unique Révélation publique : celle-ci exige notre foi; en effet, en elle, au moyen de paroles humaines et par la médiation de la communauté vivante de l’Église, Dieu lui-même nous parle. Le critère pour établir la vérité d’une révélation privée est son orientation vers le Christ lui-même. Quand celle-ci nous éloigne de Lui, alors elle ne vient certainement pas de l’Esprit Saint, qui nous conduit à l’Évangile et non hors de lui. La révélation privée est une aide pour la foi, et elle se montre crédible précisément parce qu’elle renvoie à l’unique Révélation publique. C’est pourquoi l’approbation ecclésiastique d’une révélation privée indique essentiellement que le message s’y rapportant ne contient rien qui s’oppose à la foi et aux bonnes mœurs. Il est permis de le rendre public, et les fidèles sont autorisés à y adhérer de manière prudente. Une révélation privée peut introduire de nouvelles expressions, faire émerger de nouvelles formes de piété ou en approfondir d’anciennes. Elle peut avoir un certain caractère prophétique (cf. 1 Th 5, 19-21) et elle peut être une aide valable pour comprendre et pour mieux vivre l’Évangile à l’heure actuelle. Elle ne doit donc pas être négligée. C’est une aide, qui nous est offerte, mais il n’est pas obligatoire de s’en servir. Dans tous les cas, il doit s’agir de quelque chose qui nourrit la foi, l’espérance et la charité, qui sont pour tous le chemin permanent du salut.
À lire aussi
Catégories: Réflexion biblique
Étiquettes : homélie 4e dimanche de l'Avent A, Isaïe 7 10-14, Matthieu 1 1-17, Matthieu 1 18-24, récit de l'enfance
Le Christ, roi de nos âmes
vendredi 19 novembre 2021
 Benjamin Boivin
Benjamin Boivin
Être un disciple du Christ, c'est prêter un serment d'allégeance au Roi des rois. Lorsque nous le faisons, faisons-le de manière très concrète, avec tout ce que cela implique.
Une vie qui suscite la louange de Dieu
jeudi 4 novembre 2021
 Marie Anne Torres
Marie Anne Torres
Lorsque nous vivons pleinement notre foi, nos actions, même les plus humbles, peuvent conduire d'autres vers Dieu.
Crucifié non pas pour condamner mais pour sauver : le don de Vendredi saint
mercredi 12 avril 2017
 Julian Paparella
Julian Paparella
Une réflexion sur la Passion de notre Seigneur Qu’est-ce que nous célébrons le Vendredi saint ? Pourquoi nous attardons-nous à la Passion du Christ chaque année au lieu de sauter directement dans la joie de la résurrection ? Ne savons-nous pas que Jésus est ressuscité ? Souffrons-nous d’ amnésie annuelle, en nous remémorant les mêmes évènements sans arrêt ? […]
Chasser l’aveuglement : retrouver la vue dans la lumière du Christ
vendredi 24 mars 2017
 Julian Paparella
Julian Paparella
Une réflexion pour le quatrième dimanche du Carême Il est difficile d’imaginer à quel point la vie serait différente si nous étions nés aveugles. Comment fonctionnerions-nous ? Comment percevrions-nous le monde ? Mais est-ce que la cécité physique est la seule sorte d’aveuglement ? S’agit-il du pire type d’aveuglement ? Le quatrième dimanche du Carême nous montre que ce […]
Le don de Dieu : la rencontre qui désaltère
jeudi 16 mars 2017
 Julian Paparella
Julian Paparella
Une réflexion pour le troisième dimanche du carême Nous avons tous un aspect de nous-mêmes que nous souhaiterions différent. Quelque chose en nous que nous souhaitons autre. Souvent cet aspect est une source de honte, de peur, de regret ou d’embarras. C’est quelque chose qui nous rend malheureux et que nous aimerions voir disparaître. Nous […]
SUPPORT LABEL
$50
$100
$150
$250
OTHER AMOUNT
FAIRE UN DON