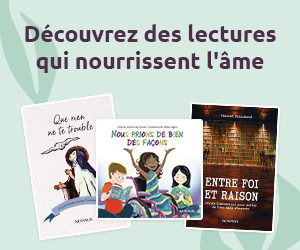– PREVIEW –
Apprendre à prier avec Abraham et Jésus
P. Thomas Rosica
Friday, July 23, 2010
Réflexion biblique pour le 17e dimanche du temps ordinaire C
 Les sites bibliques de Sodome et Gomorrhe, patrie de Lot, neveu d’Abraham, étaient infestés de péchés. La tradition israélite attribuait unanimement la destruction de Sodome et Gomorrhe à la méchanceté de ces deux villes, mais la tradition variait quant à la nature de cette méchanceté. Dans plusieurs autres interprétations, le péché de Sodome était l’homosexualité [Genèse 19, 4-5], aussi appelée sodomie ; pourtant, selon Isaïe [19, 9-10 ; 3-9], c’était le manque de justice. Ezekiel [16, 46-51] l’a décrite comme indifférence envers les démunis, tandis que Jérémie [23, 14] y voyait l’immortalité générale. Des études ultérieures ont révélé que le péché de Sodome était le grave péché de l’inhospitalité au sein du monde biblique – un assaut contre les visiteurs faibles et sans défense qui, selon la justice et la tradition, auraient dus être protégés du danger (Ezekiel 16, 49].
Session de négociation biblique
La première lecture d’aujourd’hui extraite de la Genèse [18, 20-32], présente la fameuse session de négociation biblique entre Dieu et Abraham concernant la destruction des deux villes. Lorsqu’Abraham entendît que Dieu allait juger les villes où résidait son neveu, il commençât par une question générale : Allez-vous anéantir les innocents avec les coupables [v23] ? Abraham fait appel à la nature vertueuse de Dieu, comme l’on fait lorsqu’on essaye de persuader une personne puissante de faire ce qu’il faut !
Dieu commence par 50 ; s’il y a 50 hommes vertueux, Sodome ne sera pas détruite, et Abraham mène Dieu à diminuer le nombre jusqu'à 10. Une subtile différence émerge dans la manière dont Dieu évoque l’affaire : Dieu dit que s’il existe un certain nombre de personnes vertueuses en ville, Dieu ne les détruira pas [vv28-32]. Mais dans sa première allocution, après qu’Abraham eut conclu son plaidoyer fondé sur les 50 vertueux, Dieu ne dit pas « je ne la détruirait pas, » mais plutôt « j’épargnerais l’intégralité de l’endroit par égard pour eux. » [v 26].
Cette histoire intrigante d’Abraham qui intercède pour Sodome ne s’agit pas, en effet, d’un jeu de nombres, mais elle porte sur la signification du salut accordé au vertueux dans une communauté corrompue. La ferveur de l’intercession d’Abraham entrevoit le thème central de la foi biblique: l’Amour tenace de Dieu qui refuse d’être frustré même dans le contexte des sociétés et des cultures immorales et des pécheurs. La théologie chrétienne nous apprend que l’humanité est sauvée par la vie d’une personne vertueuse !
Les éléments d’une bonne négociation
Quels sont les éléments d’une bonne négociation ? Tout d’abord, la demande ou la sollicitation doit être clairement articulée et comprise. Deuxièmement, la logique derrière la demande ou la sollicitation doit être présentée et convenue. Troisièmement, la personne qui demande ou sollicite doit persister dans la négociation. Ce qui est ultimement requis c’est la clarté, la logique et la persistance. Nous ne pouvons céder !
Abraham a utilisé les trois éléments dans sa prière à Dieu. Il a indiqué la foi et le caractère de Lot, pas le fait que Lot lui était lié par la parenté de sang. Alors qu’il n’avait jamais déclaré sa demande, Abraham a clairement présenté son propos à Dieu : Sauvez ceux qui vous adorent et agissent vertueusement ! Soyez fidèles à ceux qui vous sont fidèles ! Soyez miséricordieux envers ceux qui traitent autrui avec compassion. Abraham a persisté jusqu'à ce que Dieu et lui se sont convenus du nombre 10 [18, 26-32].
Le nombre 10 ne nous a pas indiqué la taille de sa famille ; il révélait plutôt le nombre minimal de croyants nécessaires pour former une communauté de fidèles. Il donnait la raison d’être au « miniyan » dans la tradition juive. Le Judaïsme se réfère au « quorum » de 10 mâles adultes requis pour certaines obligations. 10 était le nombre minimal requis pour la prière publique, et le nombre requis pour tenir des services dans une synagogue.
Lorsque nous prions Dieu, nous devons prendre à cœur l’exemple d’Abraham. Nous devons prier avec une demande claire, rechercher la volonté de Dieu, et persister dans la prière, même lorsque nous prions pour une intention simple. Comment sommes-nous clairs dans notre prière, logiques dans ses implications, et persistants dans sa demande ? Comment notre prière reflète-t-elle ces qualités abrahamiques ?
La centralité de la prière dans la vie chrétienne
À travers l’Évangile de Luc, Jésus en prière est pour nous un modèle. À chaque moment de prière, Jésus concrétise l’histoire du dialogue de Dieu avec la famille humaine en demeurant totalement ouvert à la puissance de Dieu. Nous devons prier insensiblement, car la prière est un signe de notre foi en Dieu. La prière est quelque chose que l’on utilise pour exercer une pression sur Dieu afin d’obtenir ce que nous désirons. La prière authentique nous ouvre à l’action de l’Esprit Saint, en nous alignant avec les désirs de Dieu, et en nous transformant en disciples sincères, obéissants à Jésus et au Père qui l’a envoyé. La prière devient une des voies par lesquelles nous suivons Jésus dans la vie chrétienne.
Trois épisodes qui portent sur la prière
Le « Notre Père » est enseigné aux douze dans leur rôle comme disciples, non seulement en tant qu’individus à convertir, mais aussi en tant que personnes déjà coresponsables de la communauté. Cette prière est une prière apostolique, car elle est récitée au pluriel et prend pour acquis le fait d’avoir une perception consciente d’un peuple, de la coresponsabilité, et de la solidarité qui nous lient les uns aux autres.
Lorsque nous prions « que ton règne vienne, » nous révélons notre désir le plus profond de voir le jour où l’omnipotence souveraine de notre Dieu aimable ne sera plus une simple espérance à laquelle on s’accroche par la foi, mais une réalité manifeste dans toutes les affaires humaines. Nos âmes ne peuvent jamais être entièrement contentes, jusqu'à ce que l’honneur de Dieu soit complètement justifiée dans toute la création. Ces paroles lancent un appel sincère : Quand est-ce que les règnes du mal et de la mort cesseront-ils ?
Lorsque nous mendions pour du pain, nous sommes, en réalité, en train de solliciter plus que de la nourriture. Nous implorons l’Auteur de la vie pour toutes les nécessités de la vie. « Dieu, donnez-nous ce dont nous avons besoin afin de jouir du don de la vie… du pain pour aujourd’hui et du pain pour demain, pour subsister en tant que communauté. »
Nous demandons à Dieu de nous pardonner nos offenses comme nous effaçons aux autres leurs dettes envers nous. Ceci pourrait possiblement refléter la préoccupation de Luc que les possessions n’entravent la solidarité communautaire. La pétition finale est plus probablement eschatologique : « ne nous soumets pas à la tentation » ; c’est-à-dire, le test définitif et ultime d’agonie et l’agonie du mal avant la fin.
Le « Notre Père » devient une prière des pauvres, de ceux qui traînent – épuisés, affamés et qui luttent pour la foi, le sens et la force. C’est, semble-t-il, que la toute première prière que nous apprenons, et la toute dernière prière que nous récitons avant de clore nos yeux sur cette vie.
L’assurance des dons de Dieu
Les sites bibliques de Sodome et Gomorrhe, patrie de Lot, neveu d’Abraham, étaient infestés de péchés. La tradition israélite attribuait unanimement la destruction de Sodome et Gomorrhe à la méchanceté de ces deux villes, mais la tradition variait quant à la nature de cette méchanceté. Dans plusieurs autres interprétations, le péché de Sodome était l’homosexualité [Genèse 19, 4-5], aussi appelée sodomie ; pourtant, selon Isaïe [19, 9-10 ; 3-9], c’était le manque de justice. Ezekiel [16, 46-51] l’a décrite comme indifférence envers les démunis, tandis que Jérémie [23, 14] y voyait l’immortalité générale. Des études ultérieures ont révélé que le péché de Sodome était le grave péché de l’inhospitalité au sein du monde biblique – un assaut contre les visiteurs faibles et sans défense qui, selon la justice et la tradition, auraient dus être protégés du danger (Ezekiel 16, 49].
Session de négociation biblique
La première lecture d’aujourd’hui extraite de la Genèse [18, 20-32], présente la fameuse session de négociation biblique entre Dieu et Abraham concernant la destruction des deux villes. Lorsqu’Abraham entendît que Dieu allait juger les villes où résidait son neveu, il commençât par une question générale : Allez-vous anéantir les innocents avec les coupables [v23] ? Abraham fait appel à la nature vertueuse de Dieu, comme l’on fait lorsqu’on essaye de persuader une personne puissante de faire ce qu’il faut !
Dieu commence par 50 ; s’il y a 50 hommes vertueux, Sodome ne sera pas détruite, et Abraham mène Dieu à diminuer le nombre jusqu'à 10. Une subtile différence émerge dans la manière dont Dieu évoque l’affaire : Dieu dit que s’il existe un certain nombre de personnes vertueuses en ville, Dieu ne les détruira pas [vv28-32]. Mais dans sa première allocution, après qu’Abraham eut conclu son plaidoyer fondé sur les 50 vertueux, Dieu ne dit pas « je ne la détruirait pas, » mais plutôt « j’épargnerais l’intégralité de l’endroit par égard pour eux. » [v 26].
Cette histoire intrigante d’Abraham qui intercède pour Sodome ne s’agit pas, en effet, d’un jeu de nombres, mais elle porte sur la signification du salut accordé au vertueux dans une communauté corrompue. La ferveur de l’intercession d’Abraham entrevoit le thème central de la foi biblique: l’Amour tenace de Dieu qui refuse d’être frustré même dans le contexte des sociétés et des cultures immorales et des pécheurs. La théologie chrétienne nous apprend que l’humanité est sauvée par la vie d’une personne vertueuse !
Les éléments d’une bonne négociation
Quels sont les éléments d’une bonne négociation ? Tout d’abord, la demande ou la sollicitation doit être clairement articulée et comprise. Deuxièmement, la logique derrière la demande ou la sollicitation doit être présentée et convenue. Troisièmement, la personne qui demande ou sollicite doit persister dans la négociation. Ce qui est ultimement requis c’est la clarté, la logique et la persistance. Nous ne pouvons céder !
Abraham a utilisé les trois éléments dans sa prière à Dieu. Il a indiqué la foi et le caractère de Lot, pas le fait que Lot lui était lié par la parenté de sang. Alors qu’il n’avait jamais déclaré sa demande, Abraham a clairement présenté son propos à Dieu : Sauvez ceux qui vous adorent et agissent vertueusement ! Soyez fidèles à ceux qui vous sont fidèles ! Soyez miséricordieux envers ceux qui traitent autrui avec compassion. Abraham a persisté jusqu'à ce que Dieu et lui se sont convenus du nombre 10 [18, 26-32].
Le nombre 10 ne nous a pas indiqué la taille de sa famille ; il révélait plutôt le nombre minimal de croyants nécessaires pour former une communauté de fidèles. Il donnait la raison d’être au « miniyan » dans la tradition juive. Le Judaïsme se réfère au « quorum » de 10 mâles adultes requis pour certaines obligations. 10 était le nombre minimal requis pour la prière publique, et le nombre requis pour tenir des services dans une synagogue.
Lorsque nous prions Dieu, nous devons prendre à cœur l’exemple d’Abraham. Nous devons prier avec une demande claire, rechercher la volonté de Dieu, et persister dans la prière, même lorsque nous prions pour une intention simple. Comment sommes-nous clairs dans notre prière, logiques dans ses implications, et persistants dans sa demande ? Comment notre prière reflète-t-elle ces qualités abrahamiques ?
La centralité de la prière dans la vie chrétienne
À travers l’Évangile de Luc, Jésus en prière est pour nous un modèle. À chaque moment de prière, Jésus concrétise l’histoire du dialogue de Dieu avec la famille humaine en demeurant totalement ouvert à la puissance de Dieu. Nous devons prier insensiblement, car la prière est un signe de notre foi en Dieu. La prière est quelque chose que l’on utilise pour exercer une pression sur Dieu afin d’obtenir ce que nous désirons. La prière authentique nous ouvre à l’action de l’Esprit Saint, en nous alignant avec les désirs de Dieu, et en nous transformant en disciples sincères, obéissants à Jésus et au Père qui l’a envoyé. La prière devient une des voies par lesquelles nous suivons Jésus dans la vie chrétienne.
Trois épisodes qui portent sur la prière
Le « Notre Père » est enseigné aux douze dans leur rôle comme disciples, non seulement en tant qu’individus à convertir, mais aussi en tant que personnes déjà coresponsables de la communauté. Cette prière est une prière apostolique, car elle est récitée au pluriel et prend pour acquis le fait d’avoir une perception consciente d’un peuple, de la coresponsabilité, et de la solidarité qui nous lient les uns aux autres.
Lorsque nous prions « que ton règne vienne, » nous révélons notre désir le plus profond de voir le jour où l’omnipotence souveraine de notre Dieu aimable ne sera plus une simple espérance à laquelle on s’accroche par la foi, mais une réalité manifeste dans toutes les affaires humaines. Nos âmes ne peuvent jamais être entièrement contentes, jusqu'à ce que l’honneur de Dieu soit complètement justifiée dans toute la création. Ces paroles lancent un appel sincère : Quand est-ce que les règnes du mal et de la mort cesseront-ils ?
Lorsque nous mendions pour du pain, nous sommes, en réalité, en train de solliciter plus que de la nourriture. Nous implorons l’Auteur de la vie pour toutes les nécessités de la vie. « Dieu, donnez-nous ce dont nous avons besoin afin de jouir du don de la vie… du pain pour aujourd’hui et du pain pour demain, pour subsister en tant que communauté. »
Nous demandons à Dieu de nous pardonner nos offenses comme nous effaçons aux autres leurs dettes envers nous. Ceci pourrait possiblement refléter la préoccupation de Luc que les possessions n’entravent la solidarité communautaire. La pétition finale est plus probablement eschatologique : « ne nous soumets pas à la tentation » ; c’est-à-dire, le test définitif et ultime d’agonie et l’agonie du mal avant la fin.
Le « Notre Père » devient une prière des pauvres, de ceux qui traînent – épuisés, affamés et qui luttent pour la foi, le sens et la force. C’est, semble-t-il, que la toute première prière que nous apprenons, et la toute dernière prière que nous récitons avant de clore nos yeux sur cette vie.
L’assurance des dons de Dieu
 La parabole de l’ami à minuit ne se trouve nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. Son message porte aussi sur la prière et son propos explique que si nos amis répondent par des sollicitations importunes et éhontées, qu’en est il alors de Dieu qui désire nous donner le Royaume [12, 32] ? La conclusion [vv9-13] élabore ce thème en se fondant sur la section précédente. L’analogie se transfert alors des amis aux parents : si les parents offrent des cadeaux, combien donc Dieu offrirait-il ? La prière doit être une demande, une recherche et des frappées à la porte continuelles ; cependant, cette persistance se trouve au sein d’une relation entre parent et enfant, qui assure ces bons dons. La prière authentique nous rend ouverts à l’action de l’Esprit de Dieu, en nous alignant avec les désirs de Dieu, et en nous transformant en vrais disciples, obéissants a Jésus et au Père qui l’a envoyé.
Je conclue cette réflexion en vous offrant deux idées au sujet de la grande leçon de Luc sur la prière dans l’évangile de ce dimanche. La première, extraite du Catéchisme de l’Eglise catholique, #239 :
La parabole de l’ami à minuit ne se trouve nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. Son message porte aussi sur la prière et son propos explique que si nos amis répondent par des sollicitations importunes et éhontées, qu’en est il alors de Dieu qui désire nous donner le Royaume [12, 32] ? La conclusion [vv9-13] élabore ce thème en se fondant sur la section précédente. L’analogie se transfert alors des amis aux parents : si les parents offrent des cadeaux, combien donc Dieu offrirait-il ? La prière doit être une demande, une recherche et des frappées à la porte continuelles ; cependant, cette persistance se trouve au sein d’une relation entre parent et enfant, qui assure ces bons dons. La prière authentique nous rend ouverts à l’action de l’Esprit de Dieu, en nous alignant avec les désirs de Dieu, et en nous transformant en vrais disciples, obéissants a Jésus et au Père qui l’a envoyé.
Je conclue cette réflexion en vous offrant deux idées au sujet de la grande leçon de Luc sur la prière dans l’évangile de ce dimanche. La première, extraite du Catéchisme de l’Eglise catholique, #239 :
 Les sites bibliques de Sodome et Gomorrhe, patrie de Lot, neveu d’Abraham, étaient infestés de péchés. La tradition israélite attribuait unanimement la destruction de Sodome et Gomorrhe à la méchanceté de ces deux villes, mais la tradition variait quant à la nature de cette méchanceté. Dans plusieurs autres interprétations, le péché de Sodome était l’homosexualité [Genèse 19, 4-5], aussi appelée sodomie ; pourtant, selon Isaïe [19, 9-10 ; 3-9], c’était le manque de justice. Ezekiel [16, 46-51] l’a décrite comme indifférence envers les démunis, tandis que Jérémie [23, 14] y voyait l’immortalité générale. Des études ultérieures ont révélé que le péché de Sodome était le grave péché de l’inhospitalité au sein du monde biblique – un assaut contre les visiteurs faibles et sans défense qui, selon la justice et la tradition, auraient dus être protégés du danger (Ezekiel 16, 49].
Session de négociation biblique
La première lecture d’aujourd’hui extraite de la Genèse [18, 20-32], présente la fameuse session de négociation biblique entre Dieu et Abraham concernant la destruction des deux villes. Lorsqu’Abraham entendît que Dieu allait juger les villes où résidait son neveu, il commençât par une question générale : Allez-vous anéantir les innocents avec les coupables [v23] ? Abraham fait appel à la nature vertueuse de Dieu, comme l’on fait lorsqu’on essaye de persuader une personne puissante de faire ce qu’il faut !
Dieu commence par 50 ; s’il y a 50 hommes vertueux, Sodome ne sera pas détruite, et Abraham mène Dieu à diminuer le nombre jusqu'à 10. Une subtile différence émerge dans la manière dont Dieu évoque l’affaire : Dieu dit que s’il existe un certain nombre de personnes vertueuses en ville, Dieu ne les détruira pas [vv28-32]. Mais dans sa première allocution, après qu’Abraham eut conclu son plaidoyer fondé sur les 50 vertueux, Dieu ne dit pas « je ne la détruirait pas, » mais plutôt « j’épargnerais l’intégralité de l’endroit par égard pour eux. » [v 26].
Cette histoire intrigante d’Abraham qui intercède pour Sodome ne s’agit pas, en effet, d’un jeu de nombres, mais elle porte sur la signification du salut accordé au vertueux dans une communauté corrompue. La ferveur de l’intercession d’Abraham entrevoit le thème central de la foi biblique: l’Amour tenace de Dieu qui refuse d’être frustré même dans le contexte des sociétés et des cultures immorales et des pécheurs. La théologie chrétienne nous apprend que l’humanité est sauvée par la vie d’une personne vertueuse !
Les éléments d’une bonne négociation
Quels sont les éléments d’une bonne négociation ? Tout d’abord, la demande ou la sollicitation doit être clairement articulée et comprise. Deuxièmement, la logique derrière la demande ou la sollicitation doit être présentée et convenue. Troisièmement, la personne qui demande ou sollicite doit persister dans la négociation. Ce qui est ultimement requis c’est la clarté, la logique et la persistance. Nous ne pouvons céder !
Abraham a utilisé les trois éléments dans sa prière à Dieu. Il a indiqué la foi et le caractère de Lot, pas le fait que Lot lui était lié par la parenté de sang. Alors qu’il n’avait jamais déclaré sa demande, Abraham a clairement présenté son propos à Dieu : Sauvez ceux qui vous adorent et agissent vertueusement ! Soyez fidèles à ceux qui vous sont fidèles ! Soyez miséricordieux envers ceux qui traitent autrui avec compassion. Abraham a persisté jusqu'à ce que Dieu et lui se sont convenus du nombre 10 [18, 26-32].
Le nombre 10 ne nous a pas indiqué la taille de sa famille ; il révélait plutôt le nombre minimal de croyants nécessaires pour former une communauté de fidèles. Il donnait la raison d’être au « miniyan » dans la tradition juive. Le Judaïsme se réfère au « quorum » de 10 mâles adultes requis pour certaines obligations. 10 était le nombre minimal requis pour la prière publique, et le nombre requis pour tenir des services dans une synagogue.
Lorsque nous prions Dieu, nous devons prendre à cœur l’exemple d’Abraham. Nous devons prier avec une demande claire, rechercher la volonté de Dieu, et persister dans la prière, même lorsque nous prions pour une intention simple. Comment sommes-nous clairs dans notre prière, logiques dans ses implications, et persistants dans sa demande ? Comment notre prière reflète-t-elle ces qualités abrahamiques ?
La centralité de la prière dans la vie chrétienne
À travers l’Évangile de Luc, Jésus en prière est pour nous un modèle. À chaque moment de prière, Jésus concrétise l’histoire du dialogue de Dieu avec la famille humaine en demeurant totalement ouvert à la puissance de Dieu. Nous devons prier insensiblement, car la prière est un signe de notre foi en Dieu. La prière est quelque chose que l’on utilise pour exercer une pression sur Dieu afin d’obtenir ce que nous désirons. La prière authentique nous ouvre à l’action de l’Esprit Saint, en nous alignant avec les désirs de Dieu, et en nous transformant en disciples sincères, obéissants à Jésus et au Père qui l’a envoyé. La prière devient une des voies par lesquelles nous suivons Jésus dans la vie chrétienne.
Trois épisodes qui portent sur la prière
Le « Notre Père » est enseigné aux douze dans leur rôle comme disciples, non seulement en tant qu’individus à convertir, mais aussi en tant que personnes déjà coresponsables de la communauté. Cette prière est une prière apostolique, car elle est récitée au pluriel et prend pour acquis le fait d’avoir une perception consciente d’un peuple, de la coresponsabilité, et de la solidarité qui nous lient les uns aux autres.
Lorsque nous prions « que ton règne vienne, » nous révélons notre désir le plus profond de voir le jour où l’omnipotence souveraine de notre Dieu aimable ne sera plus une simple espérance à laquelle on s’accroche par la foi, mais une réalité manifeste dans toutes les affaires humaines. Nos âmes ne peuvent jamais être entièrement contentes, jusqu'à ce que l’honneur de Dieu soit complètement justifiée dans toute la création. Ces paroles lancent un appel sincère : Quand est-ce que les règnes du mal et de la mort cesseront-ils ?
Lorsque nous mendions pour du pain, nous sommes, en réalité, en train de solliciter plus que de la nourriture. Nous implorons l’Auteur de la vie pour toutes les nécessités de la vie. « Dieu, donnez-nous ce dont nous avons besoin afin de jouir du don de la vie… du pain pour aujourd’hui et du pain pour demain, pour subsister en tant que communauté. »
Nous demandons à Dieu de nous pardonner nos offenses comme nous effaçons aux autres leurs dettes envers nous. Ceci pourrait possiblement refléter la préoccupation de Luc que les possessions n’entravent la solidarité communautaire. La pétition finale est plus probablement eschatologique : « ne nous soumets pas à la tentation » ; c’est-à-dire, le test définitif et ultime d’agonie et l’agonie du mal avant la fin.
Le « Notre Père » devient une prière des pauvres, de ceux qui traînent – épuisés, affamés et qui luttent pour la foi, le sens et la force. C’est, semble-t-il, que la toute première prière que nous apprenons, et la toute dernière prière que nous récitons avant de clore nos yeux sur cette vie.
L’assurance des dons de Dieu
Les sites bibliques de Sodome et Gomorrhe, patrie de Lot, neveu d’Abraham, étaient infestés de péchés. La tradition israélite attribuait unanimement la destruction de Sodome et Gomorrhe à la méchanceté de ces deux villes, mais la tradition variait quant à la nature de cette méchanceté. Dans plusieurs autres interprétations, le péché de Sodome était l’homosexualité [Genèse 19, 4-5], aussi appelée sodomie ; pourtant, selon Isaïe [19, 9-10 ; 3-9], c’était le manque de justice. Ezekiel [16, 46-51] l’a décrite comme indifférence envers les démunis, tandis que Jérémie [23, 14] y voyait l’immortalité générale. Des études ultérieures ont révélé que le péché de Sodome était le grave péché de l’inhospitalité au sein du monde biblique – un assaut contre les visiteurs faibles et sans défense qui, selon la justice et la tradition, auraient dus être protégés du danger (Ezekiel 16, 49].
Session de négociation biblique
La première lecture d’aujourd’hui extraite de la Genèse [18, 20-32], présente la fameuse session de négociation biblique entre Dieu et Abraham concernant la destruction des deux villes. Lorsqu’Abraham entendît que Dieu allait juger les villes où résidait son neveu, il commençât par une question générale : Allez-vous anéantir les innocents avec les coupables [v23] ? Abraham fait appel à la nature vertueuse de Dieu, comme l’on fait lorsqu’on essaye de persuader une personne puissante de faire ce qu’il faut !
Dieu commence par 50 ; s’il y a 50 hommes vertueux, Sodome ne sera pas détruite, et Abraham mène Dieu à diminuer le nombre jusqu'à 10. Une subtile différence émerge dans la manière dont Dieu évoque l’affaire : Dieu dit que s’il existe un certain nombre de personnes vertueuses en ville, Dieu ne les détruira pas [vv28-32]. Mais dans sa première allocution, après qu’Abraham eut conclu son plaidoyer fondé sur les 50 vertueux, Dieu ne dit pas « je ne la détruirait pas, » mais plutôt « j’épargnerais l’intégralité de l’endroit par égard pour eux. » [v 26].
Cette histoire intrigante d’Abraham qui intercède pour Sodome ne s’agit pas, en effet, d’un jeu de nombres, mais elle porte sur la signification du salut accordé au vertueux dans une communauté corrompue. La ferveur de l’intercession d’Abraham entrevoit le thème central de la foi biblique: l’Amour tenace de Dieu qui refuse d’être frustré même dans le contexte des sociétés et des cultures immorales et des pécheurs. La théologie chrétienne nous apprend que l’humanité est sauvée par la vie d’une personne vertueuse !
Les éléments d’une bonne négociation
Quels sont les éléments d’une bonne négociation ? Tout d’abord, la demande ou la sollicitation doit être clairement articulée et comprise. Deuxièmement, la logique derrière la demande ou la sollicitation doit être présentée et convenue. Troisièmement, la personne qui demande ou sollicite doit persister dans la négociation. Ce qui est ultimement requis c’est la clarté, la logique et la persistance. Nous ne pouvons céder !
Abraham a utilisé les trois éléments dans sa prière à Dieu. Il a indiqué la foi et le caractère de Lot, pas le fait que Lot lui était lié par la parenté de sang. Alors qu’il n’avait jamais déclaré sa demande, Abraham a clairement présenté son propos à Dieu : Sauvez ceux qui vous adorent et agissent vertueusement ! Soyez fidèles à ceux qui vous sont fidèles ! Soyez miséricordieux envers ceux qui traitent autrui avec compassion. Abraham a persisté jusqu'à ce que Dieu et lui se sont convenus du nombre 10 [18, 26-32].
Le nombre 10 ne nous a pas indiqué la taille de sa famille ; il révélait plutôt le nombre minimal de croyants nécessaires pour former une communauté de fidèles. Il donnait la raison d’être au « miniyan » dans la tradition juive. Le Judaïsme se réfère au « quorum » de 10 mâles adultes requis pour certaines obligations. 10 était le nombre minimal requis pour la prière publique, et le nombre requis pour tenir des services dans une synagogue.
Lorsque nous prions Dieu, nous devons prendre à cœur l’exemple d’Abraham. Nous devons prier avec une demande claire, rechercher la volonté de Dieu, et persister dans la prière, même lorsque nous prions pour une intention simple. Comment sommes-nous clairs dans notre prière, logiques dans ses implications, et persistants dans sa demande ? Comment notre prière reflète-t-elle ces qualités abrahamiques ?
La centralité de la prière dans la vie chrétienne
À travers l’Évangile de Luc, Jésus en prière est pour nous un modèle. À chaque moment de prière, Jésus concrétise l’histoire du dialogue de Dieu avec la famille humaine en demeurant totalement ouvert à la puissance de Dieu. Nous devons prier insensiblement, car la prière est un signe de notre foi en Dieu. La prière est quelque chose que l’on utilise pour exercer une pression sur Dieu afin d’obtenir ce que nous désirons. La prière authentique nous ouvre à l’action de l’Esprit Saint, en nous alignant avec les désirs de Dieu, et en nous transformant en disciples sincères, obéissants à Jésus et au Père qui l’a envoyé. La prière devient une des voies par lesquelles nous suivons Jésus dans la vie chrétienne.
Trois épisodes qui portent sur la prière
Le « Notre Père » est enseigné aux douze dans leur rôle comme disciples, non seulement en tant qu’individus à convertir, mais aussi en tant que personnes déjà coresponsables de la communauté. Cette prière est une prière apostolique, car elle est récitée au pluriel et prend pour acquis le fait d’avoir une perception consciente d’un peuple, de la coresponsabilité, et de la solidarité qui nous lient les uns aux autres.
Lorsque nous prions « que ton règne vienne, » nous révélons notre désir le plus profond de voir le jour où l’omnipotence souveraine de notre Dieu aimable ne sera plus une simple espérance à laquelle on s’accroche par la foi, mais une réalité manifeste dans toutes les affaires humaines. Nos âmes ne peuvent jamais être entièrement contentes, jusqu'à ce que l’honneur de Dieu soit complètement justifiée dans toute la création. Ces paroles lancent un appel sincère : Quand est-ce que les règnes du mal et de la mort cesseront-ils ?
Lorsque nous mendions pour du pain, nous sommes, en réalité, en train de solliciter plus que de la nourriture. Nous implorons l’Auteur de la vie pour toutes les nécessités de la vie. « Dieu, donnez-nous ce dont nous avons besoin afin de jouir du don de la vie… du pain pour aujourd’hui et du pain pour demain, pour subsister en tant que communauté. »
Nous demandons à Dieu de nous pardonner nos offenses comme nous effaçons aux autres leurs dettes envers nous. Ceci pourrait possiblement refléter la préoccupation de Luc que les possessions n’entravent la solidarité communautaire. La pétition finale est plus probablement eschatologique : « ne nous soumets pas à la tentation » ; c’est-à-dire, le test définitif et ultime d’agonie et l’agonie du mal avant la fin.
Le « Notre Père » devient une prière des pauvres, de ceux qui traînent – épuisés, affamés et qui luttent pour la foi, le sens et la force. C’est, semble-t-il, que la toute première prière que nous apprenons, et la toute dernière prière que nous récitons avant de clore nos yeux sur cette vie.
L’assurance des dons de Dieu
En désignant Dieu du nom de " Père ", le langage de la foi indique principalement deux aspects : que Dieu est origine première de tout et autorité transcendante et qu’il est en même temps bonté et sollicitude aimante pour tous ses enfants. Cette tendresse parentale de Dieu peut aussi être exprimée par l’image de la maternité (cf. Is 66, 13 ; Ps 131, 2) qui indique davantage l’immanence de Dieu, l’intimité entre Dieu et Sa créature. Le langage de la foi puise ainsi dans l’expérience humaine des parents qui sont d’une certaine façon les premiers représentants de Dieu pour l’homme. Mais cette expérience dit aussi que les parents humains sont faillibles et qu’ils peuvent défigurer le visage de la paternité et de la maternité. Il convient alors de rappeler que Dieu transcende la distinction humaine des sexes. Il n’est ni homme, ni femme, il est Dieu. Il transcende aussi la paternité et la maternité humaines (cf. Ps 27, 10), tout en en étant l’origine et la mesure (cf. Ep 3, 14 ; Is 49, 15) : Personne n’est père comme l’est Dieu.J’attire aussi votre attention aux homélies du Cardinal John Henry Newman sur l’évangile d’aujourd’hui. Le cardinal écrivait en paroles qui résonnent toujours fort et clair aujourd’hui :
Il [Jésus] a donné la prière et l’a utilisée. Ses Apôtres l’utilisèrent ; tous les Saints l’ont dès lors utilisée. Lorsque nous l’utilisons nous semblons les rejoindre. Qui ne pense se rapprocher à n’importe quel homme célèbre dans l’histoire, en voyant sa demeure, ses meubles, son écriture, ou les livres qui lui appartenaient ? C’est ainsi que la Prière du Seigneur nous rapproche de Christ, et des Ses disciples à chaque âge. Il n’est pas donc surprenant, que dans les temps dévolus les bons hommes pensaient que cette Forme de prière était tellement sacrée, qu’elle leur paraissait impossible à réciter souvent, comme si une forme de grâce spéciale disparaissait avec son usage. Ni peut-on l’utiliser très fréquemment ; elle contient en elle une sorte de sollicitation pour amener le Christ à être à notre écoute ; nous ne le pouvons, afin de garder nos pensées fixées sur ses pétitions, et utiliser nos esprits ainsi que nos lèvres lorsque on la répète. Et, ce qui est vrai pour la Prière du Seigneur, est vrai, dans une certaine mesure, pour la plus part de ces prières que notre Église nous apprend à utiliser. Ceci est également vrai pour les Psaumes ainsi que les Crédos ; qui sont tous devenus sacrés, de la mémoire des saints défunts qui les avaient utilisées, et que l’on espère rencontrer un jour au paradis. » (Extrait traduit de la source suivante : http://www.newmanreader.org/works/parochial/volume1/sermon20.html.)
Catégories:
À lire aussi
<<