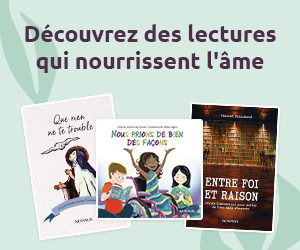– PREVIEW –
Propos de table et étiquette dans l’évangile de Luc
P. Thomas Rosica
lundi 22 août 2016

Vingt-deuxième dimanche du temps ordinaire, Année C - 28 août 2016
Ben Sirac 3,17-18.20.28-29
Hébreux 12,18-19.22-24a
Luc 14,1.7-14
Dans l’évangile de Luc, les enseignements de Jésus les plus importants ont lieu autour de la table, dans des fêtes, des célébrations. Nous découvrons que chaque repas porte un sens plus profond que le simple boire et manger en compagnie d’autrui.
Les propos de table présentés aujourd’hui s’inscrivent dans le cadre du voyage vers Jérusalem entamé au chapitre 9 verset 51. Chez Luc, rien n’a plus d’importance que la table à manger. C’est là que se déroule l’eucharistie, de même que les révélations du Ressuscité (Luc 24, v. 28 à 32). De plus, c’est en mangeant ensemble que les disciples reçoivent du Christ la promesse de l’envoi de l’Esprit Saint et leur mission spécifique (Actes 1, v. 8). Enfin, juifs et païens ont pu former Église grâce au partage du repas (Actes 10, v. 9 à 16 et 11, v. 1 à 18).
Des repas partagés lourds de sens
La scène de banquet présentée aujourd’hui ne se trouve que dans l’évangile de Luc (14, v. 7 à 14). Elle offre un cadre aux enseignements de Jésus sur l’humilité et présente son attitude envers la richesse et la pauvreté. Le partage du repas pour le judaïsme, pour Jésus et pour l’Église des premiers temps comporte une dimension religieuse, sociale et économique riche de sens.
Le premier verset du chapitre 14 pose d’emblée le contexte pour les versets 7 à 11. Attablé chez un pharisien, Jésus observe le comportement des hôtes comme des invités. L’observation attentive du quotidien lui fournissait une compréhension profonde de la véritable nature de ses auditeurs de même que des opportunités de leur révéler le fonctionnement du Royaume de Dieu. Ce qui est récurrent et coutumier ne doit pas être négligé lorsqu’on tente de définir la vie vécue dans la présence de Dieu.
L’élévation provient de Dieu, non des humains
Que devons-nous retenir de l’évangile d’aujourd’hui ? En entendant que choisir la dernière place peut non seulement éviter l’humiliation, mais également mener droit à la table d’honneur, notre égo humain, par ailleurs fort ingénieux, pourrait transformer la consigne au sujet de l’humilité en une nouvelle stratégie « d’auto-exaltation. » C’est une chose de choisir la dernière place par humilité; c’en est une autre de choisir la dernière place comme façon d’avancer plus haut ! Cet enseignement devient tout aussi ridicule s’il y a une ruée vers la dernière place avec les oreilles orientées vers l’hôte attendant avidement l’invitation à s’élever.
Ceux qui s’élèvent eux-mêmes au-dessus des autres seront abaissés; ceux qui se considèrent comme faisant partie des « humbles », aussi humain que n’importe quel qui dam, ceux-là seront élevés. Il appartient à Dieu d’élever et d’exalter; il convient à l’être humain de reconnaître sa propre humilité. On ne se rend pas humble pour l’amour de la chose en elle-même, mais pour l’amour soit de Dieu, soit du Christ.
La première lecture de ce jour, tirée du livre de Ben Sirac le Sage (chap. 3, 17-18, 20, 28-29), évoque cette humilité authentique qui donne une appréciation juste de soi (v. 7-19). Avec l’humilité, on peut accomplir son devoir et éviter ce qui dépasse son entendement et sa force (v. 20-22). L’orgueil, cependant, engendre fausse grandeur, manque de jugement, entêtement, souffrance, affliction et perdition (chap. 3, v. 23-27).
L’unique assurance
Les riches, les puissants et ceux qui se croient des « justes » trouvent très difficile d’être humblement ouvert à Dieu. C’est plutôt en leurs trésors et leur propre valeur qu’ils ont pleine confiance. L’unique assurance repose sur l’amitié avec Dieu et sur le service de Dieu : servir les humains et Dieu à l’exemple de Jésus de Nazareth. S’exalter soi-même, c’est une façon de ne compter que sur soi plutôt que de compter sur Dieu. Voilà pourquoi la richesse, la prospérité, la pleine satisfaction entraînent presque intrinsèquement l’arrogance, la fierté, le refus de Dieu.
La seconde leçon à retenir de l’évangile du jour concerne l’habitude répandue et acceptée de n’inviter que ceux dont on peut s’attendre à ce qu’ils nous retournent la faveur d’une façon ou d’une autre. Jésus renverse cette norme : n’invitez pas à partager un repas avec vous ceux qui un jour ou l’autre vous le remettront, peut-être même en surpassant le vôtre. Invitez plutôt ceux qui jamais ne sont invités à sortir – les pauvres, ceux qui vivent en marge de la société et ceux de qui vous ne pouvez attendre aucune faveur.
L’étiquette chez Luc
Le rôle d’hôte suggère plusieurs connotations agréables et positives, comme celles d’être une personne amicale, généreuse, affable et soucieuse du bien-être des autres. Jésus fait cependant remarquer (v. 12- 14) le rôle de l’hôte peut être déformé et épouvantablement détourné lorsqu’il est accompli avec attachement ! L’hôte ou l’hôtesse qui attend un « retour sur l’investissement » n’offrira pas d’attentions ni de nourriture à ceux qui ne peuvent donner en retour. Ainsi, la liste d’invités ne comporte que le nom de personnes en mesure de rendre faveur pour faveur.
Jésus nous invite à un comportement digne du Royaume : inviter ceux qui n’ont ni bien ni statut social. Dieu est notre hôte suprême et nous sommes en réalité ses invités, ne formulant aucune requête, ne plaçant aucune condition, n’attendant rien en retour. La liste de Luc qui mentionne les pauvres, les estropiés, les boiteux et les aveugles, ne surprend pas le lecteur. Nous avons déjà été informés à propos de ces personnes depuis que Marie les a chantés dans son Magnificat au début de l’évangile selon saint Luc (Lc 1, v. 46 à 55) et que Jésus s’est adressé à eux dans son sermon inaugural dans la synagogue de Nazareth (Lc 4, v. 16 à 30).
L’inconvenance et la grande indulgence de Jésus
En se faisant l’ami de gens de la sorte et en mangeant avec eux, Jésus irritait ses adversaires, comme en tant d’autres gestes qu’il posait. Ils médisaient contre lui : « Il s’est laissé inviter par un homme pécheur », ou encore « Regardez-le qui mange avec des percepteur d’impôts et des prostituées ! » Pourtant, là où ces autres ne voyaient que des pécheurs, des marginaux, des parias à haïr et à mettre à l’écart, Jésus, lui, voyait autre chose. Il voyait des êtres humains, peut-être des personnes emprisonnées dans leurs échecs, tentant désespérément de devenir meilleures et essayant maladroitement de faire amende honorable pour une vie de péché. Jésus de Nazareth s’exclamerait : « Le salut est venu aujourd’hui sur cette maison parce que cet homme est aussi un fils d’Abraham. Car le Fils de l’Homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. »
Chercher et sauver ceux qui étaient perdus, exalter les pauvres et les humbles, abaisser les riches, les impies, les hautains et les arrogants, voilà le ministère de Jésus. Ses détracteurs s’offensaient de tant d’inconvenance et d’indulgence. Tous ceux que Jésus nous recommande d’inscrire à notre liste d’invités sont ceux qui recevront les places d’honneur au banquet du Royaume : les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles, les païens, ceux qui n’ont pas de quoi nous repayer, ceux à qui on a refusé l’entrée au centre de l’ancien Temple en raison de leur statut. Les murs du nouveau temple, eux, n’excluraient personne.
Les assemblées de l’Ancienne et la Nouvelle Alliance
La seconde lecture du jour, extraite de la lettre aux Hébreux (chap. 12, v. 18, 19, 22-24a), compare les deux Alliances, celle de Moïse et celle du Christ. Ce magnifique passage relève le contraste entre deux grands rassemblements populaires : celui des Israélites attroupés au pied du mont Sinaï pour sceller la première alliance et promulguer la loi de Moïse, et celui des disciples de Jésus réunis au mont Sion, la Jérusalem céleste, l’assemblée de l’Alliance nouvelle. Avec ses innombrables anges et la présence du sang rédempteur de Jésus, cette dernière scène rappelle les liturgies célestes du Livre de l’Apocalypse.
L’Alliance de Moïse y est dépeinte comme puisant ses origines dans la peur de Dieu est les menaces de châtiments divins (Hb 12, v. 18 à 21). L’Alliance du Christ nous donne un accès direct à Dieu (v. 22), fait de nous des membres de la communauté chrétienne, des enfants de Dieu, un peuple sanctifié (v. 23) qui a Jésus pour médiateur nous défendant (v. 24). Ne pas tenir compte de la voix du Ressuscité, voilà un péché plus grave que le rejet de la parole de Moïse (v. 25 et 26). Bien que des chrétiens s’en écartent, le Royaume de Dieu en Christ demeurera et sa justice punira ceux coupables de désertion (v. 28 et 29).
« Les armes des saints » du Cardinal Newman
Considérons les paroles du Bienheureux Cardinal John Henry Newman dans l’un de ses mémorables sermons, « Les armes des saints » (« The Weapons of Saints »), portant sur l’évangile d’aujourd’hui :
Il existe un lien mystérieux entre avancement véritable et abaissement de soi. Si vous exercez votre ministère auprès des humbles et des méprisés, si vous nourrissez les affamés, soignez les malades, secourez les affligés; si vous souffrez avec les pervertis, endurez les insultes, supportez l’ingratitude, rendez le bien pour le mal, vous devenez, comme par un charme divin, plus fort que le monde et vous vous élevez parmi les créatures. Dieu a établi cette loi. Ainsi Il accomplit Ses merveilleuses œuvres. Ses instruments sont pauvres et méprisés; le monde connaît à peine leurs noms, si même il les connaît. Ses instruments sont entièrement absorbés par des actions que le monde considère comme sans importance, et personne n’y porte attention. En apparence, Ses instruments ne sont dédiés à aucune grande œuvre; on ne voit pas de fruit provenant de ce qu’ils font : ils semblent en situation d’échec. Non, même en ce qui concerne des visées religieuses qu’eux-mêmes affirment désirer, il n’existe aucune connexion naturelle et visible entre leurs actions et leurs souffrances et ces fins désirables; cependant, il y a une connexion invisible dans le Royaume de Dieu. Ils s’élèvent en tombant, purement et simplement, car aucune condescendence ne peut surpasser celle de notre Seigneur. Conséquemment, plus ils s’abaissent eux-mêmes, plus ils Lui ressemblent; et plus ils Lui ressemblent, plus grande doit être leur puissance avec Lui.L’étiquette de Mère Teresa Puisque nous commémorerons la naissance de la Bienheureuse Teresa de Calcutta le 26 août, ainsi que l’anniversaire de son décès le 5 septembre, laissons ses mots des « Commandements Paradoxaux » qui lui sont souvent faussement attribués résonner à nos oreilles et dans nos communautés cette semaine. Cette année, ses paroles prennent une signification particulière, puisque Mère Teresa sera canonisé par le Pape François le 4 septembre. Lorsque Mère Teresa entendit ces mots de Kent M. Keith pour la première fois, elle fut poussée à les afficher sur le mur d’un de ses foyers des enfants à Calcutta. Ces maximes sont une inspiration qui aide à trouver un sens personnel face à l’adversité, et transcendent tous les crédos et les cultures. Plus que tout, le « crédo » du Dr. Keith décrit très bien le charisme de Mère Teresa dans sa relation avec un grand nombre de personnes durant sa vie. Elle comprenait bien la prédilection de l’évangéliste Luc pour les propos de table et l’étiquette de Jésus.
Les gens sont souvent déraisonnables, irrationnels, centrés sur eux-mêmes. Pardonne-leur quand même. Si tu faits preuve de bonté, des gens pourraient t’accuser d’intentions égoïstes dissimulées. Sois bon quand même. Si tu connais du succès, tu gagneras quelques amitiés déloyales et quelques véritables ennemis. Réussis quand même. Si tu es honnête et sincère, les gens pourraient te tromper. Sois honnête et sincère quand même. Ce que tu auras mis des années à créer, d’autres pourraient le détruire du jour au lendemain. Crée malgré cela. Si tu trouves de la sérénité et du bonheur, certains pourraient être jaloux. Sois heureux malgré eux. Le bien que tu auras fait aujourd’hui sera souvent oublié. Faits le bien malgré cela. Donne le meilleur de toi-même et ce ne sera jamais assez. Donne malgré tout le meilleur de toi-même. Au final, tout cela sera entre toi et Dieu. Ça n’a jamais été entre toi et eux de toute façon.(Image : Le Souper à Emmaüs du Caravage)
Catégories:
À lire aussi
>>
SUPPORT LABEL
$50
$100
$150
$250
OTHER AMOUNT
FAIRE UN DON
Recevez nos infolettres
Recevez nos infolettres