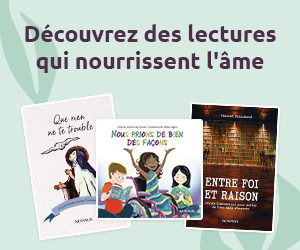– PREVIEW –
Un engagement authentique envers Jésus Christ change notre style de vie et nos relations
P. Thomas Rosica
Tuesday, August 9, 2016

Réflexion du père Thomas Rosica c.s.b. pour le Vingtième dimanche du temps ordinaire ( 7 août 2016) Jérémie 38,4-6.8-10; Hébreux 12,1-4; Luc 12,49-53
Les lectures bibliques pour le vingtième dimanche du temps ordinaire nous invitent à considérer les implications de nos engagements, de nos styles de vie, et de nos relations avec les autres. Dans la première lecture de Jérémie (38,4-6.8-10), le prophète est appelé à réconforter les affligés et d’affliger ceux qui sont confortables. Par la suite, Jésus aura le même sort que ce prophète.
Dans la deuxième lecture de la lettre aux Hébreux (12,1-4), nous apprenons que Jésus, le grand architecte de la foi chrétienne, a dû lui-même endurer la croix avant de recevoir la gloire et le triomphe. Une réflexion sur sa souffrance nous donne le courage de continuer la lutte, lutte si nécessaire qu’elle peut éventuellement nous appeler à verser notre propre sang. Nous devons considérer nos propres souffrances comme la correction affectueuse du Seigneur, qui nous aime comme un père aime ses enfants.
Dans l’Évangile d’aujourd’hui (Luc 12,49-53), Jésus rappelle à la foule que ceux qui s’engagent sur le chemin avec lui verront même leurs relations avec leurs amis et les membres de leurs familles être transformées. Un engagement sérieux avec Jésus nous oblige à changer la manière dont nous vivons nos vies, et cela peut mettre de la pression sur nos relations. On ne s’attend pas à trouver des paroles de Jésus à ce point difficiles dans les Évangiles. Toutefois c’est une bonne chose de se rappeler de temps en temps que la décision de faire la bonne chose, la meilleure chose, n’est pas toujours facile ou sans conflit. Jésus lui-même n’a pas pris que des décisions faciles ni cherché démesurément à éviter les conflits. Ainsi, Jésus rappelle à ses disciples qu’ils doivent se préparer à prendre des décisions difficiles et à faire face aux conflits.
Jésus demande une décision pour ou contre son message
Le baptême mentionné dans l’Évangile d’aujourd’hui représente la passion et la mort du Christ. Il attend impatiemment que cet évènement se passe (Luc 12,50). Les membres des familles sont divisés les uns contre les autres. La dure réalité est que la mission de conversion confiée à l’Église ne sera pas un succès complet. Jésus demande une décision pour ou contre son message : « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! » (Luc 12,49). Jésus n’a pas tergiversé en se résignant devant certaines décisions difficiles par peur de ne pas être accepté. Il n’a pas cherché l’harmonie ou la voie modérée dans chaque dispute. Il a fait face aux grands conflits de son époque sans peur de prendre des décisions difficiles.
Réfléchissons pendant un instant sur notre propre manque de courage et de conviction lorsque nous avons à prendre plusieurs décisions importantes dans nos vies. Plusieurs d’entre nous maintiennent que les chrétiens doivent toujours chercher l’accord et le juste milieu. Nous pouvons être trompés et croire que la tension et le conflit sont plus mauvais que l’injustice et l’oppression. Nous mettons beaucoup d’importance sur le fait d’être aimés et acceptés par tout le monde ! Et souvent nous avons peur de révéler qui nous sommes et ce que nous croyons, même à ceux et celles que nous considérons comme amis ! Nous avons peur d’être rejetés !
Ceux et celles qui ont peur des conflits ou de la confrontation, même quand ce n’est pas violent, résistent aux changements. La véritable question consiste plutôt à se demander : qu’est-ce qu’une réconciliation authentique ? Plusieurs personnes voudraient croire que Jésus a apporté un message de paix et de réconciliation. En ce sens, il est tout à fait vrai que l’une des choses que Jésus a voulu transmettre à ses disciples était sa paix, et qu’il a proclamé : « Bienheureux les artisans de paix ! », mais cela doit être compris dans le contexte d’une déclaration encore plus provocante de Jésus, racontée par deux des évangélistes : « Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais cinq personnes de la même famille seront divisées : trois contre deux et deux contre trois ; ils se diviseront : le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère » (Luc 12,51-53 ; Matthieu 10,34-36).
Jésus n’a pas employé cette citation biblique du prophète Michée pour démontrer qu’il était une personnalité ou un maître de division, ni parce qu’il désirait apporter la dissension et le conflit, ni pour asseoir son autorité et commander en maître en exposant sa connaissance intime de la loi et des prophètes de la tradition ancienne d’Israël. Jésus a plutôt voulu enseigner à ses disciples que sa position intransigeante diviserait inévitablement les gens entre ceux qui sont pour lui et ceux qui sont contre lui. Jésus ne s’est jamais engagé dans un concours de popularité.
De plus, dans la saga continue de conflits entre les pharisiens et les soi-disant « pécheurs », Jésus de Nazareth s’est rallié avec les pécheurs, les prostituées, et les collecteurs d’impôts contre les pharisiens. Dans le conflit entre les riches et les pauvres, Jésus s’est rallié avec les pauvres. Jésus n’a pas traité les deux côtés également comme étant tous deux justes et injustes ; il n’a pas dit aux gens de simplement surmonter leurs difficultés et leurs différends, mais plutôt de se secouer la main et de se réconcilier ! Jésus a condamné les pharisiens et les riches explicitement, et il a pardonné les pécheurs et a béni les pauvres sans réserve. Il est toujours entré en conflit avec les pharisiens et les riches et c’est pourquoi ils ont voulu le discréditer, l’arrêter, l’inculper, et l’exécuter.
Jésus ne s’est jamais compromis lui-même ou ses convictions pour être en accord avec les pouvoirs de son époque ou par un irénisme faux. Pour Jésus, la question ne fut jamais de préserver la paix et l’unité à tout prix, mais de ne jamais perdre de vue la vérité et la justice. Au contraire, sa volonté était de promouvoir la vérité et la justice à tout prix, même lorsque cela impliquait de créer le conflit et la dissension.
Il y a plusieurs occasions dans les Écritures où Jésus fait tout son possible pour réconcilier les personnes en désaccord les uns avec les autres (les juifs et les samaritains, les zélotes, les collecteurs d’impôts, quelques pharisiens et les pécheurs ou les pauvres, etc.). À cause de ses actions avec ces personnes, il était reconnu comme un homme de paix. Pourtant, Jésus a toujours fait une distinction entre la paix que Dieu veut, et la paix que le monde veut (Jean 14,27). La paix que Dieu veut est une paix fondée sur la vérité, la justice et l’amour. La paix que le monde offre est une paix et une unité superficielles qui compromettent la vérité, cachent les injustices, habituellement le résultat de motivations complètement égoïstes. Jésus détruit cette fausse paix en provoquant parfois même le conflit dans le but de promouvoir une paix vraie et durable.
La paix c’est le destin ultime du Royaume de Dieu, mais elle coûte chère. Jésus avertit la foule que partout là où la Parole de Dieu est entendue et vécue, des divisions apparaîtront.
Conforter les affligés dans une « favela » brésilien
À la suite de son élection comme Pape, le pape François a lancé son appel pour « une Église pauvre pour les pauvres ». Lors de sa visite historique à Rio de Janeiro pour les Journées Mondiales de la Jeunesse 2013 au Brésil, le pape François a visité la communauté de Varginha dans la « favela » (ou « bidonville ») de Manguinhos. Ces lieux appauvris étaient à la fois minés par la violence, la drogue et les luttes entre des gangs. Cette communauté est un vif exemple de pauvreté dévastatrice, de développement inégal, et des profondes divisions de classe qui tourmentent le Brésil alors même que le pays essaie de se transformer. Le pape François s’est adressé à une foule immense de résidents de Varginha, rassemblés dans un champ de football de ce bidonville où règne la violence. Des sections de son message incarnent bien l’Évangile d’aujourd’hui :
Et le peuple brésilien, en particulier les personnes plus simples, peut offrir au monde une précieuse leçon de solidarité, une parole – cette parole solidarité – souvent oubliée ou tuée, parce qu’elle gêne. Elle semble presque une mauvaise parole … solidarité. Je voudrais faire appel à celui qui possède plus de ressources, aux autorités publiques et à tous les hommes de bonne volonté engagés pour la justice sociale : ne vous lassez pas de travailler pour un monde plus juste et plus solidaire ! Personne ne peut rester insensible aux inégalités qu’il y a encore dans le monde ! Que chacun, selon ses possibilités et ses responsabilités, sache offrir sa contribution pour mettre fin à beaucoup d’injustices sociales. Ce n’est pas la culture de l’égoïsme, de l’individualisme qui souvent régule notre société, celle qui construit et mène vers un monde plus habitable ; ce n’est pas celle-là, mais la culture de la solidarité ; la culture de la solidarité c’est voir dans l’autre non un concurrent ou un numéro, mais un frère. Et nous sommes tous frères !Je désire encourager les efforts que la société brésilienne fait pour intégrer toutes ses composantes, même les plus souffrantes et nécessiteuses, dans la lutte contre la faim et la misère. Aucun effort de “pacification” ne sera durable, il n’y aura ni harmonie, ni bonheur pour une société qui ignore, qui met en marge et abandonne dans la périphérie une partie d’elle-même. Une telle société s’appauvrit ainsi simplement et perd même quelque chose d’essentiel pour elle-même. Ne laissons pas, ne laissons pas entrer dans notre cœur la culture de l’exclusion ! Ne laissons pas entrer dans notre cœur la culture de l’exclusion, parce que nous sommes frères. Personne n’est à exclure ! Rappelons-nous-le toujours : c’est seulement quand nous sommes capables de partager que nous nous enrichissons vraiment ; tout ce qui se partage se multiplie ! Pensons à la multiplication des pains de Jésus ! La mesure de la grandeur d’une société est donnée par la façon dont elle traite celui qui est le plus nécessiteux, qui n’a rien d’autre que sa pauvreté !Il n’y a ni de véritable promotion du bien commun, ni de véritable développement de l’homme quand on ignore les piliers fondamentaux qui soutiennent une Nation, ses biens immatériels : la vie, qui est don de Dieu, valeur à préserver et à promouvoir toujours ; la famille, fondement de la vie ensemble et remède contre l’effritement social ; l’éducation intégrale, qui ne se réduit pas à une simple transmission d’informations dans le but de produire du profit ; la santé, qui doit chercher le bien-être intégral de la personne, aussi dans sa dimension spirituelle, essentielle pour l’équilibre humain et pour une saine vie en commun ; la sécurité, dans la conviction que la violence peut être vaincue seulement à partir du changement du cœur humain.
Comme Jésus, le pape François demande qu’une décision soit prise pour ou contre son message. L’Évêque de Rome ne cherche pas l’harmonie ni une voie modérée dans chaque situation que ce soit dans le problème de la pauvreté extrême, de l’injustice ou de la violence. Il n’a pas peur d’entrer au milieu des grands conflits de notre temps et il est prêt à prendre les décisions difficiles et nécessaires dans l’intérêt d’une réconciliation authentique, d’une justice véritable, et la paix durable entre les peuples. Apprenons de l’exemple de Jésus de Nazareth ainsi que de François de Buenos Aires.
À lire aussi
<<
SUPPORT LABEL
$50
$100
$150
$250
OTHER AMOUNT
DONATE
Receive our newsletters
Stay Connected
Receive our newsletters

Stay Connected